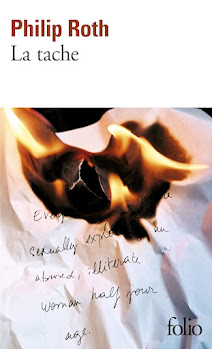En cette année 2057, le soleil se
meurt, entraînant dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine. Le
vaisseau spatial ICARUS II avec à son bord un équipage de 7 hommes et
femmes dirigé par le Capitaine Kaneda est le dernier espoir de
l'humanité. Leur mission : faire exploser un engin nucléaire à la
surface du soleil pour relancer l'activité solaire. Mais à l'approche du
soleil, privés de tout contact radio avec la Terre, les astronautes
perçoivent un signal de détresse en provenance d'ICARUS I, disparu sept
ans auparavant.
Certains des meilleurs films de Danny
Boyle traitent souvent d'un groupe de personnages en quête d'un ailleurs
idéalisé qui donnera un tour plus attractif et vrais à leurs vies. Cet
ailleurs peut prendre les atours les plus triviaux avec l'appât du gain
de
Petits meurtres entre amis (1994), les paradis artificiels de
Trainspotting (1996) ou l'idéal hippie de façade dans
La Plage
(2000). Dans les premiers films du réalisateur, les héros sont presque
toujours condamnés à se perdre (hormis la comédie romantique
Une vie moins ordinaire
(1997) tandis que dans les années 2000 le voyage spirituel se fera de
plus en plus positif et lumineux : l'espoir surgit au final du monde
apocalyptique de
28 Jours plus tard (2002), l'argent est au service des autres dans le bancal
Millions (2004) et on a un vrai conte moderne avec
Slumdog Millionaire (2008).
Sunshine entremêle toutes ces facettes à travers l'excellent scénario d'Alex Garland.
Dans chacun des précédents films les héros se brûlaient les ailes en approchant leur rêve et
Sunshine
prend littéralement le principe au pied de la lettre. Dans un futur
proche où le soleil se meurt et menace l'humanité d'extinction, une
mission spatiale de la dernière chance est envoyée afin d'y déposer une
bombe nucléaire dont la déflagration réanimera l'astre. Quelques années
plus tôt une première mission avait disparu mystérieusement. On retrouve
le brio du Ridley Scott de Alien (1979) dans la façon qu'a Boyle de
caractériser de façon limpide l'ensemble de l'équipage cosmopolite à
travers leurs fonctions à bord. Le réfléchi et introverti Capa (Cillian
Murphy) en charge de la bombe, le taiseux et charismatique capitaine
Kaneda (Hiroyuki Sanada), la plus sensible Corazon s'occupant de la
serre à oxygène ou le plus valeureux et fougueux Mace (excellent Chris
Evans).

La découverte inattendue d'Icarus 1 vaisseau de la première
mission puis différentes défaillances techniques vont mettre à mal la
mission et exacerber les tensions au sein de l'équipage. La première
scène du film voit le personnage de Searle (Cliff Curtis) affronter,
fasciné et jusqu'à l'aveuglement l'éclat de ce soleil si proche. L'astre
se présentera tout au long du récit comme un symbole de vie et de mort,
dans les deux cas un objet de fascination dont on ne peut détourner le
regard.
En se noyant dans sa lumière immaculée les protagonistes s'y
confrontent à leurs espoirs et peurs, notamment le cauchemar réccurent de chacun se voyant tomber à sa surface. Capable de calciner cruellement et
dans une vraie poésie certains personnages, le soleil peut également les
maintenir en vie tout en consumant leur âme, en altérant leur raison.
Tous les héros se retrouveront ainsi dépassé par la situation et leurs
émotions dans une réflexion pas si éloignée du
Narcisse Noir
(1947) de Powell/Pressburger (qui pour info est le grand père du producteur
historique de Boyle, Andrew Macdonald) où face à la beauté ultime, on ne
peut que fuir ou perdre la raison (Powell et Pressburger étant une influence assumée de Boyle notamment
Une Vie moins ordinaire qui doit tout à
Une question de vie ou de mort (1946).
Boyle y ajoute une dimension
religieuse ou la mission s'avère être une sorte de défi à Dieu ayant
décidé de la fin de l'humanité, plongeant l'équipage dans la confusion à
l'image d'une tour de Babel. Se rapprocher aussi près du soleil c'est
une manière de tutoyer le créateur et évidemment la facette mythologique
est omniprésente aussi avec le nom du vaisseau, Icarus.
Boyle
allie rigueur et spectaculaire, chaos et contemplatif dans un tout
cohérent qui captive par sa sobriété dans la première partie et envoute
dans la seconde un mysticisme de plus en plus marqué. Les effets
spéciaux sont superbes et le design du vaisseau très réussi, Boyle là
aussi en plein dans l'école SF 70's donnant un tour fonctionnel et
jamais clinquant aux outils en place. La musique planante d'Underworld
et John Murphy ajoute à ce côté fascinant où le réalisateur tisse
certaines images somptueuses comme la disparition de Kaneda (tandis que
Searle le supplie de lui raconter ce qu'il voit en ces derniers
instants).
La dernière partie est un peu plus bancale avec
l'instauration d'une menace inattendue amenant une mise en scène plus
frénétique et gorgée de tics agaçant (et évoque des influences moins
nobles comme le
Event Horizon
(1997), de Paul W. Anderson) même si sur le fond cela est parfaitement
logique aux thématiques progressivement mises en place. La montée en
puissance conserve cependant toute son émotion (même si là aussi on cède
à quelques incohérences alors que tout ce tenait plutôt bien jusque-là,
le physicien anglais Brian Cox apportant conseils et précisions sur les
aspects scientifiques du film durant le tournage), avec des dernières
images où les rayons du soleil se font à la fois destructeurs dans une
ultime orgie de flamme mais aussi rédempteur avec cette somptueuse aube
terrestre, celle d'un nouveau départ pour l'humanité. On n'est pas passé
loin du vrai classique SF mais en tout cas
Sunshine est une des plus
belles réussites du genre dans les années 2000.
Sorti en dvd zone 2 français chez Fox