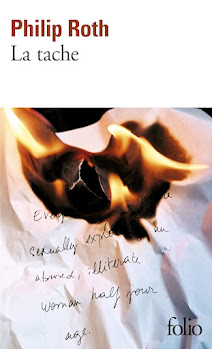L'histoire se passe en Europe il y a environ 35 000 ans ;
les groupes d'humains modernes (Cro-Magnon) commencent à peupler le
continent occupé jusqu'alors par l'homme de Neandertal. Ayla, une petite
fille qui a perdu ses parents lors d'un tremblement de terre, est
attaquée par un lion des cavernes. Bien qu'elle se soit cachée dans une
crevasse de rocher, la fillette est blessée par l'une des puissantes
griffes de l'animal. Quasiment morte de faim et gravement blessée, elle
est découverte par un groupe d'hommes de Neandertal qui passait par là.
Elle est soignée par Iza, la femme-médecin, et Creb, le sorcier ou
Mog-Ur. Tous les deux s'attachent beaucoup à Ayla, même si pour le reste
du clan elle demeure une étrangère dont on ne veut pas. Broud, le fils
du chef de clan, la hait particulièrement.
Une vraie curiosité que cette aventure préhistorique dont l'échec
commercial cuisant stoppa quelque peu l'ascension de Daryl Hannah
devenue star après ses rôles d'adolescente tourmentée dans Reckless (1984) et surtout de sirène dans Splash (1984). Le film adaptait en fait le roman éponyme de Jean Auel et premier volet de sa saga littéraire Les Enfants de la Terre.
Cette série en six tomes narrait la rencontre et le passage de relai
entre l'homme de Cro-Magnon l'humain moderne et l'homme des cavernes
amené à disparaitre, l'homme de Neandertal. Cette bascule se fait dans
l'histoire avec le personnage de Ayla (Daryl Hannah), appartenant au
Cro-Magnon mais qui orpheline est recueillie par le clan de la Caverne
de l'Ours. Sa différence est marquée d'emblée par sa chevelure blonde et
par son attitude candide qui va rapidement se confronter au
fonctionnement patriarcal du clan.
Si les romans de Jean Auel sont réputés pour la véracité de leur
description du quotidien préhistorique (de plus en plus d'ailleurs le
succès aidant en plus de ses connaissances paléontologiques étendues sur le sujet elle put
consulter les plus grands spécialistes et visiter les sites
préhistoriques les plus reculés où se déroulait ses histoires) le film
n'opte ni pour la fantaisie de Un millions d'années avant JC (1966) (pas de trace de dinosaure ici) et ni pour le côté réaliste plus austère de La Guerre du Feu
(1981) de Jean-Jacques Annaud. On se situe plutôt entre les deux avec
une voix off donnant une dimension mystique et légendaire aux évènements
alors qu'à que l'intrigue suit globalement le quotidien du clan des
ours sans envolées ni grande aventure particulière.
On pourrait craindre
le nanar avec tout ce casting grimé et ainsi vêtu de peau de bête mais
Michael Chapman amène une vraie rigueur dans sa description notamment
par le langage assez primitif (moins radical que le livre où les
personnages communiquaient uniquement par signe) et donc des échanges et
des sentiments qui passent grandement par l'image et la conviction des
acteurs, la voix off amenant une certaine hauteur aux évènements.
L'évolution de l'Homme passe donc ici par une sorte de prémisse du
féminisme à travers le parcours initiatique et l'évolution du personnage
de Ayla. Naturellement dotée de faculté intellectuelle supérieure, elle
est pourtant entravée par les rites de soumission à l'autorité
masculine du clan.
La femme n'a pas le droit de chasser, doit servir
l'homme et est totalement dépendante des désirs sexuels de celui-ci
auxquels elle se doit de répondre sans contester. Personne n'abuse de
ses prérogatives si ce n'est Broud (Thomas G. Waites) le fils du chef
qui déteste et désire Ayla, cherchant à briser ses velléités
d'émancipation. Chapman parvient à dépeindre tout cela avec précision,
l'austérité des coutumes du clan étant contrebalancé par le caractère
rêveur de Ayla qui sera élevé par la guérisseuse et le sorcier (James Remar) de la
tribu, l'une ayant "surmonté" sa féminité et l'autre son handicap
physique (puisqu'il est sous-entendu que le clan pratique l'eugénisme et
que les faible sont laissés en chemin) pour s'élever dans la
hiérarchie.
Le kitsch guette à chaque instant (on a beau être à la préhistoire
certaine coupe de cheveux ne font pas oublier que tout cela a bien été
produit dans les 80's) mais finalement on est réellement captivé par
l'atmosphère très intimiste. Chapman laisse la part belle aux
ambiances contemplatives où sont mis en valeur les paysages de
l'Okanogan (Canada) croisant forêts boisée à pertes de vue et cadre
rocailleux, ainsi que la faune dangereuse qu'il abrite avec des loups et
des ours (pour l'anecdote l'ours du film a un beau cv puisqu'on le
retrouvera dans L'Ours de Jean-Jacques Annaud, Légendes d'Automne (1994) ou encore le survival À couteaux tirés
(1997) et également de belles scènes onirique (le rêve révélant son
destin à Ayla).
Daryl Hannah entre visage farouche et allure innocente
est particulièrement convaincante, Chapman exprimant un souffle épique
surprenant dès qu'elle décide de s'opposer à la tradition (la scène
d'exil, celle où elle s'entraîne à manier la fronde et surtout le
superbe combat final), portée par un beau score synthétique d'Alan
Silvestri. Ayla ne doit pas s'élever au-dessus des autres mais trouver
sa place, une quête reposant sur la rencontre avec les "Autres", ses
semblables Cro-Magnon que nous ne croiserons pas du film. Une piste
laissée aux nombreuses suites envisagées mais qui tournèrent court suite
à l'échec du film. Dommage tant ce premier volet s'avérait prometteur
et que le film vaut mieux que sa piètre réputation.
Sorti en dvd zone 2 français chez TF1 vidéo mais l'édition semble épuisée et assez chère donc se tourner plutôt vers le zone 1 Warner bien plus abordable et doté de sous-titre français.
Extrait
[Film] Door III, de Kurosawa Kiyoshi (1996)
Il y a 15 minutes